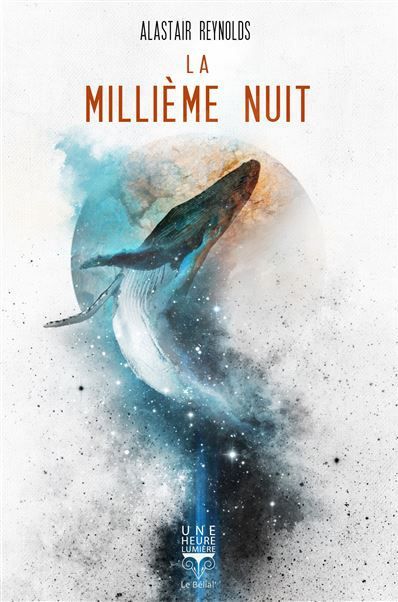Vampires et zombies dans la culture populaire
Si vampyres et zombis se côtoient souvent, une grande opposition semble demeurer entre eux. Si les dérives hédonistes de la bit-lit nuisent à la littérature vampyrique, elle n’écorna cependant que très peu le caractère noble, au sens propre comme au sens figuré, du monstre bien connu. En effet, contrairement au zombi, le vampyre semble bénéficier d’un certain élitisme, qui se traduit aussi bien dans sa représentation que dans son acception littéraire, tandis que l’autre a une dimension vulgaire, au sens latin de vulgus, soit de « masse » et de « commun aux hommes ». Bien qu’appartenant aujourd’hui à la culture populaire, leurs origines leur conférèrent un rôle différent, qui nous marqua intensément, quand bien même cette dissension paraîtrait infinitésimale pour certains. Pourtant, la mythopoétique de ces êtres horrifiques se fonde sur deux idées bien différentes, même si la peur est leur principal moteur.
DE L’IMPORTANCE FOLKLORIQUE
Si le zombi est aujourd’hui une figure des plus populaires, son arrivée dans l’imaginaire européen fut très tardive. Créature plus exotique, il ne bénéficia pas de la longue digestion européenne du vampyre, et ne fit sa véritable apparition à la seconde moitié du XXe siècle.
Origines folkloriques
La première dichotomie entre vampyres et zombis provient bien évidemment de leurs origines. Si le vampyre est ancré depuis des siècles dans le folklore européen, notamment slave où il connaît plusieurs déclinaisons, le zombi est un être plus exotique. Provenant du vaudou, il se développa notamment dans la culture haïtienne où il ne s’agissait pas d’un réel mort-vivant comme on l’entend aujourd’hui, mais un état cataleptique que la victime atteint après avoir ingurgité plusieurs drogues et être enterré vingt-quatre heures afin que le manque d’oxygène provoque des lésions cérébrales, mais aussi pour que le sorcier vaudou fasse croire à une résurrection. L’évolution occidentale du mythe, si elle se fondait à la base sur les spectres, même si la Renaissance accéléra l’assimilation au mort-vivant que l’on connaît aujourd’hui, comme en témoignent des œuvres picturales telles que Le Chevalier, la jeune fille et la Mort. Néanmoins, les deux mythes ont pour dénominateur commun l’idée d’un Homme revenu d’entre les morts, enterré ou non, anthropophage. Une autre antinomie réside dans leur dénomination générique. Si le français ne parle que de « mort-vivant », l’anglais est plus nuancé et parlera plus volontiers d’« undead » pour les vampyres et de « living-dead » pour les zombis. Les vampyres sont en effet considérés comme « non-morts », non seulement car immortels, mais aussi parce que leur état physiologique se rapproche du défunt. Il doit ainsi sommeiller à certains intervalles dans son cercueil, voire dans la terre de ses ancêtres, et ses pouvoirs ne fonctionnent véritablement qu’à la nuit tombée. À l’inverse, le zombi est indifférent à ces cycles ; il erre tel un pantin, mais se désagrège là où son homologue peut rajeunir en se nourrissant. C’est un « mort-vivant » au sens premier du mot, car il ne dispose plus d’aucune empathie, ni d’aucun réel besoin autre que celui de se nourrir de chair humaine.

Cette divergence folklorique a son importance, puisqu’elle gouverne encore aujourd’hui les dissemblances entre vampyres et zombis, notamment en matière littéraire, où ces derniers accusent une véritable absence de genèse, pouvant expliquer en partie pourquoi la littérature vampyrique conserve une aura d’élitisme.
Genèse et absence de genèse littéraires
Le vampyre est en effet une figure littéraire majeure en Europe, qui date du tout début du XIXe siècle sous sa forme romancée, bien que des écrits datent déjà du XVIIIe siècle (pour en savoir plus, nous vous invitons à lire le compte-rendu de la conférence dédiée aux vampyres). De fait, le vampyre a eu tout le loisir d’évoluer et d’être diffusé au sein des cultures européennes, même s’il connaitra sa quintessence sous la plume de Bram Stoker dans son inoubliableDracula. Bien que Frankenstein incarne la première figure du mort-vivant dans la littérature anglo-saxonne, et demeure paradoxalement la plus fidèle à l’imaginaire vaudou, son intelligence et son rapport avec son créateur l’éloignent de l’état cataleptique du zombi. Il en est de même pour la fameuse nouvelle Herbert West, réanimateur de Lovecraft, où les morts-vivants cherchent à se venger d’avoir été ramenés à la vie, même si certaines caractéristiques seront reprises par Romero. En réalité, il a fallu justement attendre La Nuit des Morts-Vivants, sorti en 1968, pour que le concept de zombi tel que nous le connaissons émerge enfin. Or, le vampyre a déjà eu son lot de films, de romans, de renouvellement, voire de mutation littéraire. Il s’est ancré dans la culture populaire, mais à l’heure où Romero sort son film, les multiples adaptations de Dracula apparaissent déjà comme surannées auprès du spectateur. Le zombi peut donc combler le manque d’originalité en matière horrifique, mais tire notamment son épingle du jeu dans sa représentation symbolique, aux antipodes de celle du vampyre.
Cependant, l’esthétique est elle aussi déjà entérinée par les codes cinématographiques. De Nosferatu au Dracula joué par Christopher Lee, le vampyre a un code vestimentaire stéréotypé par ses nombreuses apparitions dans les salles obscures. Outre qu’il porte toujours des vêtements à dominante noire, les films avec Lugosi et Lee lui attribuèrent une dimension baroque, où le monstre se retrouve affublé d’une cape à doublure écarlate, les cheveux gominés et le port foncièrement aristocrate. Cela impacte bien sûr directement sur la représentation symboliste de ces créatures, l’une s’inscrivant dans la mystique, tandis que l’autre se veut reflet de notre société.
DE L’IMPORTANCE SYMBOLISTE
Deux éléments majeurs se dégagent dans le symbolisme du vampyre et du zombi. Le premier réside dans leur nourriture, qui influe sur la représentation du corps, l’autre sur la représentation sociale qu’ils incarnent.
Nourriture
En effet, le sang et la chair, que consomment respectivement le vampyre et le zombi, ont une symbolique distincte, et inhérente à leurs natures. On l’a dit, le vampyre est un « non-mort ». S’il peut vieillir, c’est parce qu’il ne consomme pas, ou pas assez, d’hémoglobine pour maintenir son corps dans une jeunesse éternelle, bien qu’il puisse la recouvrer comme on le voit largement dansDracula. La mystique du sang comme symbole de vie, voire d’éternelle jeunesse, n’est plus à expliquer ; c’est donc naturellement qu’elle devint la principale caractéristique du vampyre. Sa qualité de non-mort prend tout son sens du fait qu’il doive s’abreuver de la source même de la vie, comme un parasite. L’allégorie du parasite n’est d’ailleurs pas totalement étrangère à la façon dont il se nourrit. Carmilla, dans le roman éponyme de Le Fanu, ne vide pas sa victime dès le premier soir, mais quotidiennement, l’affaiblissant. Sa représentation est alors celle d’une masse noire, informe et effrayante, qui mord sa victime au sein, et non dans le cou. Ce choix était d’autant plus subtil que le sein symbolise à la foi l’érotisme, mais aussi la maternité, soit l’allégorie parfaite de la vie et de la création.
Ici, la dernière tentative de Carmilla de se nourrir de Laura.
Or, le zombi se situe aux antipodes de cette pureté. Anthropophage, la chair qu’il dévore ne freine pas pour autant sa décomposition. La chair, contrairement au sang, revêt une allégorie du vulgaire en général, mais la consommation qu’en fait le mort-vivant s’attache à en faire une incarnation abêtissante, sinon bestiale. Le zombi n’a pas de rituel complexe comme le vampyre ; il se jette sauvagement sur sa proie, qu’il ne dévore même pas entièrement. Tel un rebut, son action nivelle le monde à son image, alors que le vampyre choisit qui sera transformé ou non. Le zombi ne s’embarrasse pas de sélection, il dévore tout ce qu’il peut, sans jamais être repu, parce que ses capacités cognitives sont trop primitives pour calmer son insatiabilité.
La représentation du corps, comme allégorie ou reflet social, est afférente à leur manière de s’alimenter. Alors que le Vampyre boit du sang pour rester jeune, cela ne l’empêche pourtant pas de gagner en puissance avec le temps, comme nous l’indique Van Helsing. Cela est représenté dans son apparence. Outre son port aristocrate qui est flagrant dans les films, les romans vampyriques font largement état de leur charisme, de leur voix en tant que vecteur de puissance permettant de commander aux éléments, sinon aux cadavres. Son raffinement est surtout défini dans Dracula, bien que Carmilla fasse longuement état de la beauté irradiante du vampyre lorsqu’il se nourrit régulièrement. La non-mort est ainsi idéalisée par le vampyre, faisant presque de lui un être supérieur. Cela est bien entendu aussi voulu par le cadre romanesque dans laquelle il naquit. Le courant gothique, avec ses châteaux hantés et ses sombres forêts impénétrables, s’intéresse toujours aux milieux élevés de la société, dont le vampyre constitue le parasite, voilà pourquoi, non content de mimer leurs codes, il les sublime. L’idée d’élitisme se retrouve aussi dans le fait, constant en littérature vampyrique, que le non-mort fut lui-même un noble, de Goethe et sa Fiancée de Corinthe à la Dame au Linceul de Stoker, en passant par Dumas père.
L’aspect baroque du vampyre cinématographique accentue sa dimension aristocrate, quoique désuète.
Il n’en est rien pour le zombi. Le cannibalisme, s’il a diverses explications pseudo-scientifiques (assimilation de certaines protéines, hypertrophie du paléocortex), ne ralentit pas la détérioration du corps, ni ne le renforce. Sa désagrégation renvoie ainsi à son caractère éphémère et terrien. Il demeure vulgaire dans la globalité de son être, de sa démarche de somnambule à ses gémissements, il est le négatif du vampyre en tant que représentation mort-vivante.
Reflets sociaux
Bien entendu, tout cela procède du rôle que revêtent ses figures comme reflets de notre société. C’est notamment le cas du zombi, qui fut pensé par Romero comme une dénonciation de la société de consommation. Les consommateurs sont ainsi assimilés à des zombis, leur déchéance physique est afférente à l’acculturation de l’individu. Le fait de consommer indéfiniment leur est commun, à la recherche perpétuelle d’insatisfaction puisqu’ils ne dévorent jamais totalement leur victime. Le consommateur est semblable, comme le mort-vivant, il est incapable de réfléchir, suivant ses pairs dès qu’il les entend gémir. Ces représentations de consommateurs fonctionnant par foules sont anciennes, de l’ochlocratie d’Aristote à la « fièvre d’obéissance à un ordre non énoncé » que décryptait Pasolini. Le zombi est donc l’allégorie de l’homme-masse, incapable de réfléchir, mais conditionné à la consommation. Faible individuellement, c’est en groupe qu’il révèle sa force terrifiante, prête à submerger toute résistance, soit pour l’absorber, soit pour l’annihiler. La contamination, plus directe et plus grossière, ne représente en fin de compte que la capacité de la société de consommation à imposer ses propres modèles.
Zombis dans un supermarché, la boucle est bouclée.
Le vampyre est d’une nature, encore une fois, toute autre et bien plus subtile. Il analyse ses proies, à la recherche de leur point faible, pour les exploiter. Il y a un calcul froid qui est effectué chez lui, au point que l’on puisse se demander s’il ne s’attache pas sincèrement à ses victimes. Il n’est ainsi pas le reflet de la société, mais sa némésis, profitant de ses faiblesses pour mieux la posséder.
Article originellement publié sur Apocryphos.
Partagez cet article :